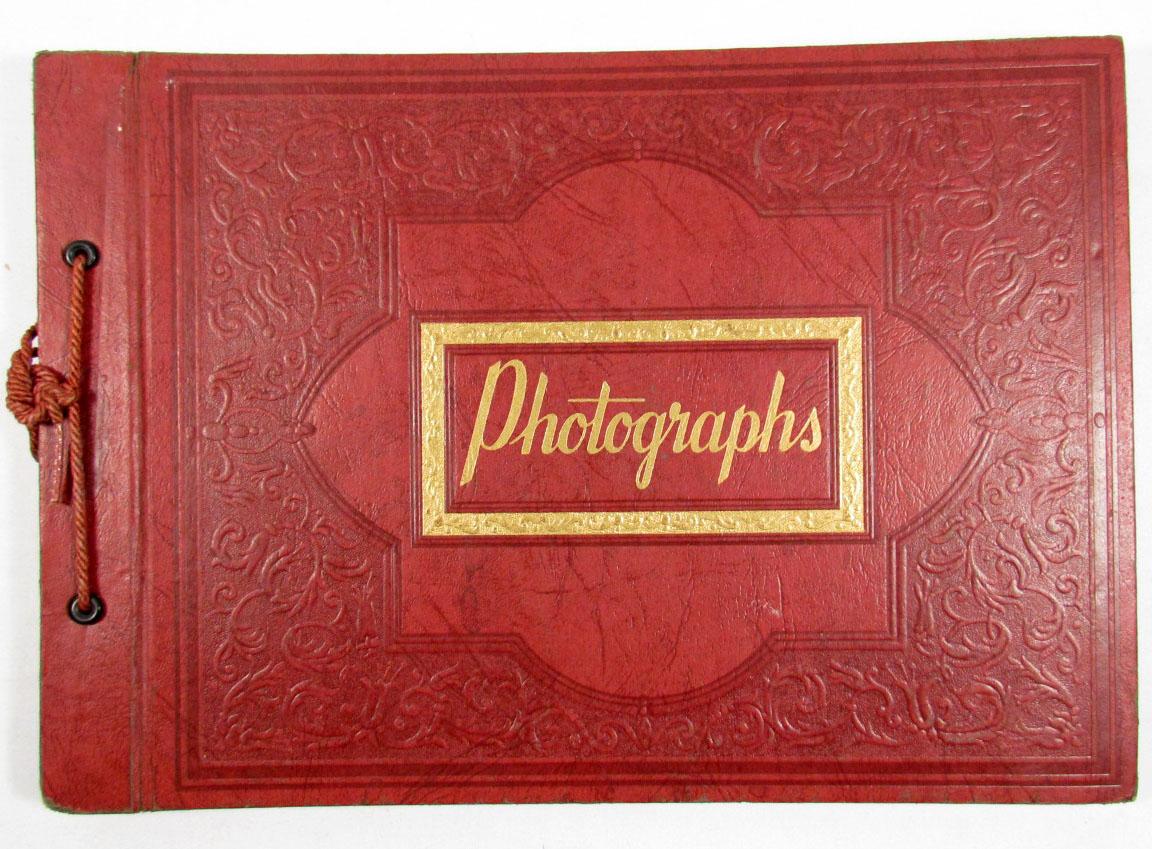CONSO
IBUPROFENE
L’ibuprofène, une molécule loin d’être sans danger
Soraya Ghali Journaliste au Vif.
Complications pulmonaires, infections sévères, troubles digestifs… Les effets indésirables de cet anti-inflammatoire accessible sans ordonnance imposent la prudence.
Qui n’a pas d’ibuprofène dans sa pharmacie? Figurant parmi les AINS (anti- inflammatoires non stéroïdiens), c’est l’un des médicaments les plus utilisés en automédication comme antalgique (contre la douleur) ou comme antipyrétique (contre la fièvre). Un geste potentiellement dangereux dans certains cas. En 2016, déjà, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) alertait sur les risques de ce produit. Comme ses homologues européens, elle retapait sur le clou, en 2020, puis, à nouveau, en 2023, en appelant à la prudence: «Le prendre à la plus faible dose efficace pendant la durée la plus courte, c’est-à-dire pas plus de trois jours en cas de fièvre et de cinq jours en cas de douleur.» En effet, cette molécule, «très utile à des pathologies adaptées», est loin d’être sans danger. La liste des effets secondaires n’a d’ailleurs cessé de s’allonger ces dernières années.
Pris durant une courte période, en cas d’infection (rhino-pharyngite, angine, otite…), l’ibuprofène réduit l’action du système immunitaire et risque alors d’aggraver l’état du malade. Comment un médicament qui soulage la douleur d’un côté peut-il exacerber une infection de l’autre? Puisque cet anti-inflammatoire masque les symptômes et leur évolution, en faisant diminuer la fièvre, il conduit à reporter la prise en charge de l’infection qui, elle, continue de se développer. Les chercheurs pensent d’ailleurs que la substance retarde l’arrivée des cellules du système immunitaire au niveau des sites infectés.
Lire aussi| L’inquiétant succès du tramadol: « Je ressentais un apaisement, un flottement »
Inflammation bloquée
Ce phénomène est intrinsèquement lié à son mode d’action. Contrairement au paracétamol, l’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce qui signifie qu’il agit en bloquant l’inflammation. Cette réaction du système immunitaire indispensable pour combattre virus, bactéries ou champignons peut provoquer des douleurs. Par exemple, le mal dû à un abcès dentaire sera bien atténué par l’ibuprofène, mais, dans le même temps, les micro-organismes pathogènes auront tout le loisir de se multiplier, en l’absence de réaction inflammatoire.
Ce n’est pas la seule explication. Certains AINS auraient une action directe sur les germes à l’origine de l’infection. Ainsi des études menées chez l’animal ont montré que l’ibuprofène favorisait la croissance de certaines bactéries, même en présence d’antibiotiques. L’antalgique, selon les chercheurs, modifierait une protéine, la vimentine, qui intervient dans la prolifération de ces bactéries. Un phénomène qui serait spécifique aux infections à streptocoques et à pneumocoques.
L’anti-inflammatoire expose également à des troubles digestifs. Ici encore, ils sont le résultat de son mécanisme de lutte contre la douleur. L’ibuprofène agit en inhibant une enzyme appelée cyclooxygénase (COX) impliquée dans certains rhumatismes, mais cette enzyme est aussi garante de l’intégrité de la muqueuse de l’estomac. Cela devient alors un cercle vicieux: en augmentant l’acidité, il favorise les maux de ventre, allant du simple inconfort jusqu’à l’ulcère. Enfin, pris pendant de longues périodes, les anti-inflammatoires augmentent également les risques d’insuffisance rénale.
La fin du libre accès?
De tout cela, concluent les agences des médicaments européennes, le paracétamol est à privilégier en première intention, car la liste des effets indésirables des AINS ne s’arrête pas là. Assez rapidement, l’ibuprofène a été soupçonné d’accroître, certes légèrement, le risque de problèmes cardiovasculaires, comme l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral, à des doses élevées (au moins 2 400 mg, soit la dose maximale autorisée, double de la dose habituellement utilisée).
Lire aussi | Paracétamol: les risques de dommages irréversibles pour le foie
Pour limiter les risques, l’Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis fin au libre accès en pharmacie de ces familles de médicaments. Depuis janvier 2020, ce sont les pharmaciens, au comptoir, qui délivrent ces produits aux personnes souhaitant les acheter sans ordonnance, l’objectif étant de débanaliser leur utilisation. Le paracétamol et l’aspirine ont subi le même sort.
En Belgique, des experts, à l’instar de Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie à l’UNamur et membre de l’Agence européenne des médicaments (EMA), demandent que la même mesure soit appliquée dans notre pays, estimant que les risques, lors d’une utilisation inadéquate, demeurent sous-estimés, particulièrement parmi le grand public. En vain.
La molécule en chiffres
Niveau 1
L’ibuprofène est vendu en pharmacie sous ce nom ainsi que sous ceux de Nurofen, Spidifen, Brufen… Délivré sans prescription pour les doses en dessous de 400 mg, il se classe parmi les antalgiques de niveau 1 et est destiné aux douleurs légères à modérées.
Troisième «coupable»
Dans de nombreux pays, le paracétamol ou l’ibuprofène dominent la liste des agents impliqués dans les intoxications (involontaires ou volontaires). Une étude menée au Royaume-Uni, en 2018, a confirmé que les analgésiques en vente libre étaient la première cause des intoxications potentiellement mortelles chez les jeunes de 10 à 24 ans. En premier lieu, le paracétamol (40%), connu pour sa toxicité hépatique, devant l’alcool (33%) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (11,6%).
7% des futures mères absorbent de l’ibuprofène dangereux pour le fœtus et 30% l’ignorent, selon une enquête des Mutualités libres. Déjà «formellement contre-indiqué» à partir du sixième mois de la grossesse, car susceptible de causer des atteintes cardiaques et rénales potentiellement fatales chez le fœtus ou le nouveau-né, l’anti-inflammatoire serait également nocif dès le premier trimestre pour le futur appareil génital et reproducteur de l’enfant de sexe masculin. L’ibuprofène ne doit pas être confondu avec la cortisone, également un anti-inflammatoire mais plus puissant. Il est employé dans les traitements de certaines formes de rhumatisme et d’arthrose, des tendinites, des lombalgies, des sciatiques ou encore des règles douloureuses.
Sportifs, pas d’excès!
Hormis les traitements médicaux à long terme, notamment pour soigner l’arthrite, c’est surtout dans le milieu du sport, professionnel ou amateur, que la consommation d’ibuprofène est la plus forte, voire excessive. Dans certaines disciplines, près de la moitié des athlètes en prennent régulièrement, dans l’espoir d’atténuer la douleur ou d’augmenter leurs performances. Mais la molécule pourrait nuire aux testicules. Une recherche franco-danoise réalisée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) auprès d’une trentaine de sportifs âgés de 18 à 35 ans a montré qu’après à peine trois semaines de prise d’ibuprofène (1 200 mg), les sujets présentaient un déficit de testostérone – hormone doublement importante pour la production de spermatozoïdes et pour la bonne santé des muscles, des os et de l’équilibre mental. Pour compenser, l’hypophyse «pompe». Trop. Soumise à ce surrégime, elle risque fort de provoquer le burnout, entraînant un effondrement du niveau de testostérone et des problèmes musculaires, osseux (comme de l’ostéoporose), voire psychologiques (perte de libido, déprime…). Cependant, selon les chercheurs eux-mêmes, de nombreuses inconnues demeurent: les résultats seraient-ils identiques si la quantité était réduite? Quels sont les effets chez les sportifs qui prennent de faibles doses mais durant de longues années? Quelles sont les conditions de réversibilité? L’Inserm mène actuellement une étude similaire sur les femmes.
Dans le Vif du 19 octobre 2023
Pour sauver le climat, faut-il bannir le steak de nos assiettes?
Journaliste au Vifhier à 06:22Mise à jour le: hier à 09:19Du 19/10/2023 du Le Vif
La consommation de bœuf, porc, agneau, poulet n’a jamais autant suscité le débat. La semaine belge sans viande risque d’encore l’attiser. Pour sauver le climat, faut-il bannir le steak de nos assiettes? Et si on en mangeait moins tout simplement…
Peut-on encore manger de la viande? Les positions sont souvent tranchées entre végés ou vegans, qui souhaitent que l’assiette se mette au vert, et amateurs de barbecue, qui voient rouge lorsqu’on remet en cause leur plaisir de mordre dans une entrecôte. Cette polarisation ne devrait pas s’amenuiser avec la Semaine sans viande qui se déroulera en Belgique du 23 au 29 octobre. Après les Pays-Bas, où l’action a démarré avec succès en 2018, notre pays est le premier à lancer cette campagne à laquelle s’associent plus de 25 entreprises alimentaires, dont Delhaize et Carrefour, avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du Green Deal. L’Allemagne et le Danemark suivront le mouvement l’année prochaine.
Les consommateurs ne semblent pas prêts à payer le kilo de bœuf un ou deux euros de plus.
Dans les pays développés, on consomme toujours des quantités astronomiques de viande, alors que les gaz produits par la digestion du bétail contribuent de manière significative à l’effet de serre – donc aux dégâts climatiques et environnementaux. L’homme cohabite aujourd’hui avec 22 milliards de poulets, plus d’un milliard de bovins, autant de moutons, des centaines de millions de porcs... Et cela ne semble pas près de diminuer.
Le Belge mange 81 kilos de viande par an
Les statistiques de la FAO, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, sont sans équivoque: la consommation mondiale de viande a doublé au cours des vingt dernières années et continue d’augmenter. Elle devrait même progresser de 15% d’ici à 2031 et de 40% d’ici à 2050. La moyenne mondiale actuelle, par personne et par an, est de 43 kilos équivalent carcasse (inclus le gras et les os). Les Etats-Unis se taillent la part du lion, avec 120 kilos: la consommation de bœuf y a néanmoins diminué d’un tiers en trois décennies, mais celle de poulet y a plus que doublé. De manière globale, la volaille et le porc, moins chers que les autres viandes, sont en plein boom. La Belgique se situe autour de 81 kilos de viande par an par personne, ce qui représente la moyenne européenne. Sur le Vieux Continent, les Espagnols viennent en tête (cent kilos).
Si la consommation de viande connaît toujours un essor à l’échelle planétaire, c’est surtout dû aux pays émergents, où la hausse des revenus et l’urbanisation poussent à acheter plus de produits carnés et laitiers. La Chine constitue désormais, en volume, le plus grand marché de la viande. Malgré cela, la consommation individuelle moyenne des Chinois ne représente encore que la moitié de celle des Nord-Américains. A l’autre bout de la fourchette, l’Afrique se montre bien moins carnivore: 17 kilos par personne. Mais la FAO y prévoit un bond de plus de 200% d’ici à 2050. La demande mondiale de viande s’était pourtant légèrement contractée en 2020. Cette baisse avait été attribuée au Covid, bien qu’une autre contraction ait déjà été constatée, pour la première fois, l’année précédente. Un retournement de tendance de courte durée ; la demande est repartie à la hausse en 2021.
Les éleveurs ont le blues
Tous ces chiffres justifient-ils une campagne sans viande pendant une semaine? «C’est vraiment une publicité négative pour les éleveurs, déplore Florian Poncelet, président de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) en Wallonie, lui-même éleveur de blanc bleu belge (BBB) à Léglise, en province de Luxembourg. Le message de cette campagne est: si on y arrive pendant une semaine, on pourrait très bien se passer de viande en permanence…» Les éleveurs se plaignent de plus en plus de la mauvaise image qu’on leur inflige. Beaucoup baissent les bras.
Lire aussi| Les Wallons toujours grands consommateur de viande
En Wallonie, les cheptels, et surtout leurs détenteurs, se réduisent de plus en plus: – 30% pour les premiers et – 67% pour les seconds, en trente ans. En 2020, on comptait encore près de neuf mille éleveurs wallons. Ils étaient moins de 7 500 en 2021. Même constat en France, où le nombre d’exploitations d’élevage a chuté de 62% depuis 1990, selon la Chambre d’agriculture. En cause: après la crise de la «vache folle» en 1996, la crise financière de 2008 et la sortie des quotas laitiers en 2015, c’est aujourd’hui en raison des effets de la viande sur le climat et la santé que le métier est discrédité.
Les bovins, champions toutes catégories
Il est vrai que les Belges, comme la plupart de leurs voisins européens, en surconsomment, trois à quatre fois plus que ce qui est recommandé par l’OMS, qui rappelle qu’une consommation excessive de viande rouge (bœuf, veau, porc, agneau, mouton) et surtout de produits carnés transformés (salami, jambons, nuggets…) augmente les risques de cancer colorectal ou intestinal et de maladies cardiovasculaires. Quant au climat, l’impact du secteur agricole sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) est estimé à plus de 14% du total des émissions d’origine anthropique, donc due à l’activité humaine, selon Francesco Tubiello, statisticien à la FAO. Et à 40% du total des émissions de méthane.
La majeure partie de ces GES agricoles proviennent de l’élevage, plus particulièrement du méthane dispersé par les pets et les rots des ruminants ainsi que du lisier et du fumier, dans une moindre mesure de la culture des céréales destinées à leur alimentation. Les champions en matière d’empreinte carbone sont les bovins. La production d’un kilo de viande de bœuf émet quatre fois plus de GES qu’un kilo de poulet. Davantage que les autres denrées, la viande coûte cher à la planète. Dans son dernier rapport, le Giec l’épingle: «La réduction de la consommation excessive de viande est l’une des mesures les plus efficaces pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, avec un potentiel élevé de cobénéfices en matière d’environnement, de santé, de sécurité alimentaire, de biodiversité.»
Idées fausses et simplismes
Si tous ces constats chiffrés impressionnent, il faut néanmoins se méfier des généralisations parfois abusives, surtout concernant les bovins. Ainsi, le chiffre souvent avancé pour la consommation en eau que nécessite la production d’un kilo de bœuf: quinze mille litres, selon la plateforme Water Footprint Network (WFN) qui englobe dans son calcul toutes les eaux de pluie absorbées par les prairies. «Voilà l’exemple symptomatique d’une approche simpliste, considère Philippe Baret, professeur d’agroécologie à l’UCLouvain. Le calcul n’est pas le même pour les vaches du Texas ou de la Pampa argentine que pour celles de Wallonie, moins aride et où l’élevage intensif est très peu présent.» En France, l’Institut national de recherche pour l’agriculture et l’environnement a remis en cause la méthode de WFN, conçue pour des exploitations industrielles. Selon son expertise, il faut entre 550 et sept cents litres d’eau pour produire un kilo de viande de bœuf.
Autre exemple: le fumier des bovins, source d’émissions de CO2 et de protoxyde d’azote nocif pour le climat, présente, en contrepartie, des vertus pour les terres cultivées, entre autres en Europe qui privilégie les grandes cultures et les monocultures, lesquelles appauvrissent les sols. Selon la FAO, un tiers des terres agricoles mondiales sont aujourd’hui dégradées, à cause de l’érosion des sols et de l’épuisement de leurs réserves nutritives. Or, le fumier, composé d’éléments fertilisants et de la flore des ruminants, permet de redonner vie à ces terres usées.
La solution est dans le pré
La pollution due aux émissions de méthane des vaches mérite aussi d’être nuancée. En effet, en contrepartie de ces émissions, l’herbe des prairies, que broutent les ruminants, capture le CO2 de l’air pour le convertir en glucides via la photosynthèse. En France, le site viande.fr, alimenté par des lobbies de la viande, affirme que ce stockage de carbone dans les prairies et les haies qui les bordent compenserait, en moyenne, 30% des émissions de GES de l’élevage herbivore.
Lire aussi| Dix pistes pour réduire sa consommation de viande
Cela paraît beaucoup. Françoise Lessire, chercheuse à la faculté de médecine vétérinaire de l’ULiège, a, elle, fait le calcul sur un grand nombre d’exploitations wallonnes dans le cadre de projets européens de recherche visant à diminuer les émissions de méthane des vaches. «Dans les prairies du sud du pays, la compensation du stockage permet de diminuer de 10% en moyenne l’empreinte carbone des élevages bovins, constate-t-elle. Dans certaines exploitations comme celle que nous avons récemment visitée dans le Luxembourg, cela peut aller jusqu’à 50%, mais cela reste exceptionnel.» Il est également important de distinguer les prairies permanentes et les prairies temporaires. Ces dernières, qui font l’objet d’une rotation entre élevage et culture, stockent moins de carbone. «C’est dû au fait qu’elles sont retournées tous les deux ou trois ans pour les cultures, précise la Dr Lessire. Lorsqu’elles sont labourées, elles libèrent du CO2 qu’elles ont emprisonné.»
Réconcilier éleveurs et consommateurs
Par ailleurs, de nombreuses études ont été lancées pour diminuer les émissions de méthane en adaptant l’alimentation des ruminants. Les graines de lin ou de colza, par exemple, riches en lipides, facilitent la digestion des vaches et permettent de réduire les émissions de 15% à 30%. Plus récemment, des chercheurs ont découvert que des additifs de synthèse à base de nitrates et de 3-nitrooxypropanol (3-NOP) – lequel agit sur les bactéries de la panse – donnent encore de meilleurs résultats. Autre piste connue qui se développe: l’alimentation animale à base de drêches des brasseries, surtout pour les fermes qui se situent à proximité de celles-ci. «Mais tout cela a un coût que les éleveurs ne peuvent pas toujours se permettre, note Françoise Lessire. C’est pourquoi la meilleure voie à suivre reste le stockage de carbone dans les prairies.»
Le fumier, composé d’éléments fertilisants et de la flore des ruminants, permet de redonner vie aux terres usées.
Les vertus des prairies ne valent évidemment que pour les élevages non intensifs (autrement dit, extensifs). Le problème, c’est l’industrialisation avec des exploitations hors-sol, sans pâturage. Mais une trop grande densité de bovins dans les prairies n’est pas bonne non plus, car cela inhibe leur rôle de stockage de CO2. «Dans tous les cas, pour préserver la planète, il faut diminuer les cheptels et la consommation de viande, en privilégiant les élevages extensifs», affirme Philippe Baret. Cette sentence n’a rien de surprenant. Même si le bétail en élevage intensif émet moins de méthane, les élevages de plus petites tailles en prairies constituent l’avenir. Ils nécessitent d’utiliser moins d’aliments extérieurs à la ferme, ce qui n’est pas négligeable dans un monde où le tiers de la production de céréales sert à fabriquer de la nourriture pour animaux. En outre, les prairies contribuent à la sauvegarde de la biodiversité, autre enjeu majeur pour la planète.
Mais, dans ce schéma, un enjeu crucial est que les éleveurs s’y retrouvent financièrement. «Aujourd’hui, nous sommes coincés entre les fournisseurs d’aliments pour animaux et la grande distribution, détaille Florian Poncelet. Les éleveurs sont la variable d’ajustement pour les marges de prix. Les prix nous sont imposés à la vente pour les aliments, et à l’achat par les supermarchés. La vente locale directe reste rare. Les consommateurs ne semblent pas prêts à payer le kilo de bœuf un ou deux euros de plus.» Il y a deux ans, Philippe Baret et son équipe de chercheurs ont réalisé, pour le WWF, une étude comparant les performances économiques des exploitations laitières et de viande. Résultat: il n’y a pas de différences majeures entre les systèmes extensifs qui diminuent leurs coûts de production grâce à l’autonomie fourragère (pâturages et aliments produits sur la ferme) et les systèmes intensifs qui importent du soja et engrangent des revenus en produisant de grosses quantités de viande.
La logique du budget viande
«Pour que se développe le système extensif et préserver l’environnement, l’enjeu est que la consommation de viande diminue d’un à deux tiers, signale le Pr Baret. Pour cela, les supermarchés doivent cesser de faire de la viande un produit d’appel. La grande distribution se vante de contribuer à un monde durable, mais elle continue à vendre du steak et du poulet premier prix. C’est absurde!» Les consommateurs, surtout les moins aisés, ne risquent-il pas néanmoins d’en faire les frais? «Pas si on passe d’une logique de prix à une logique de budget viande, poursuit l’ingénieur en agroécologie. Les chiffres de Statbel montrent que les ménages modestes ne consomment pas moins de viande que les autres, au contraire. Si on ne mange de la viande non industrielle, un peu plus chère, qu’un jour sur deux ou sur trois, le budget viande n’en sera pas affecté.»
Lire aussi| Les vaches émettent moins de méthane grâce aux restes de bières
Pour Philippe Baret, le dialogue est ce qui manque le plus. Pour cela, il faut d’abord se fixer des objectifs collectifs, un peu comme pour les voitures thermiques. Exemple: interdire les importations de soja pour le bétail d’ici à 2030. Or, aujourd’hui, on fait les choses à l’envers: on met tout sur le dos de l’éleveur, qui ne peut imposer ses prix, et du consommateur qui – c’est humain – fait ses achats en fonction des promos. Il y a un an, la ville de Haarlem, aux Pays-Bas, a interdit la publicité pour la viande. Une décision radicale. En Suisse, un plan d’action fédéral vise à limiter, pour la viande, les pubs du genre «2 pour 1» qui incitent à l’achat et au gaspillage.
«L’Etat peut actionner beaucoup de leviers, notamment dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les maisons de repos, pour diminuer la consommation de viande, avance Albane Aubry, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace. Quant aux supermarchés, l’Etat pourrait les empêcher de faire de la promo pour la viande industrielle. Ou, du moins, les obliger à équilibrer l’offre de produits animaux et de produits végétaux dans leurs rayons, avec des cibles pour 2030-2050 et des reportings à la clé.» Les substituts végétaux à la viande et au lait sont d’ailleurs en pleine explosion dans de nombreux pays: leurs ventes mondiales devraient avoir quadruplé en 2025 par rapport à 2020 pour les premiers et doublé pour les seconds.
Si la semaine sans viande permet de nourrir un débat constructif autour de tous ces aspects, sans crisper les différents acteurs, ce sera gagné.
Machiste, le barbecue?
N’en déplaise aux détracteurs de la députée écologiste française Sandrine Rousseau, qui avait provoqué un tollé l’an dernier en associant le barbecue au virilisme, une enquête de l’Ifop, réalisée à la suite de la polémique, a montré que près de 80% des hommes en couple s’occupent plus souvent du barbecue que leur compagne et près de la moitié – surtout les gros consommateurs de bœuf – sont persuadés qu’ils s’en occupent mieux que les femmes. Par ailleurs, le sondage révèle une politisation autour des enjeux liés à la nourriture: ainsi, les 18% de Français qui se revendiquent comme «très viandards» sont majoritairement «à droite et très à droite». Ce sont surtout des électeurs d’Eric Zemmour, un peu moins ceux de Marine Le Pen et des Républicains.
La réaction des lobbies
Face au discrédit que subissent les éleveurs, du secteur bovin en particulier, le lobby de la viande s’organise en déployant des campagnes de pub massives dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux. Celles-ci ciblent largement les millenials et les enfants, a constaté l’association Greenpeace France dans une enquête réalisée l’an dernier. Interbev, le lobby français de la viande rouge, tente aussi d’influencer médecins et diététiciens, en leur envoyant des brochures vantant les bienfaits de la viande pour la santé. Greenpeace a, en outre, pointé le «“science-washing” du lobby de la viande qui nourrit des liens étroits avec la recherche publique et intègre des réseaux scientifiques».
Les pubs pro-viande ciblent surtout les millenials et les enfants.
Le même lobby s’est approprié le concept de flexitarisme, qui désigne le régime alimentaire de ceux qui ne mangent pas beaucoup de viande ou occasionnellement. Dans sa campagne 2023, Interbev redéfinit le terme de flexitarien qui «privilégie autant le plaisir que la qualité, l’équilibre et la variété, le local et la durabilité», sans évoquer le fait de manger moins de viande. En Belgique, la Febev, qui représente les abattoirs, les ateliers de découpe et les grossistes, cherche aussi, depuis quelques années, à redorer l’image du secteur qui a connu quelques scandales sanitaires. La Fédération refuse qu’on associe la publicité pour la viande à celle pour le tabac, comme l’a fait Greenpeace en pointant des stratégies qui jouent sur les idéaux masculins ou sur la promesse d’un lien social en partageant un bon steak.
«Une des solutions pour améliorer l’empreinte écologique du secteur de la viande consiste à réduire les pertes et gaspillages alimentaires», note le dernier rapport «Perspectives agricoles» de l’OCDE et de la FAO. Et pour cause. Dans l’Union européenne, souligne le même rapport, près d’un quart de la production de viande est jeté à la poubelle, si l’on tient compte de tous les stades de la filière. La majeure partie (64%) de ce gaspillage est attribuée à la consommation, surtout aux ménages mais également à l’Horeca, aux cantines, etc. Le reste concerne essentiellement la transformation (problèmes de chaînes du froid, lots contaminés, erreurs d’étiquetage…) et la distribution (invendus non redistribués, emballages abîmés…).
Chez les ménages, les principales causes sont de trop grandes quantités achetées, les restes de repas gardés, le dépassement de la date de péremption (voir graphique page 22). Le Boston Consulting Group, lui, a calculé que la viande et les produits laitiers représentaient près de 15% du gaspillage alimentaire mondial. Les émissions de GES de l’élevage pourraient donc être réduites d’autant, sans le gaspillage. Notons (par ordre décroissant) que les consommateurs d’Amérique du Nord, d’Europe et de l’Asie industrialisée gaspillent neuf à dix fois plus que ceux du reste du monde. L’Union européenne s’est engagée à réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici à 2030.
Date de dernière mise à jour : 22/10/2023
Ajouter un commentaire